Bullshit Jobs
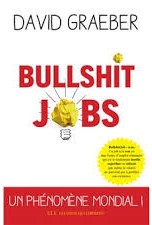
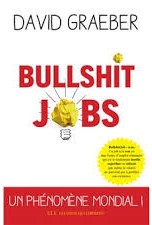 Tout a commencé en 2013 : David Graeber, anthropologue américain anarchiste, professeur à la London School of Economics, a publié dans Strike! Magazine, une revue en ligne radicale, un petit article intitulé « Le phénomène des bullshit jobs » ( litt. jobs à la con).
Tout a commencé en 2013 : David Graeber, anthropologue américain anarchiste, professeur à la London School of Economics, a publié dans Strike! Magazine, une revue en ligne radicale, un petit article intitulé « Le phénomène des bullshit jobs » ( litt. jobs à la con).
Le retentissement de cet article a dépassé tout ce que pouvait imaginer son auteur :
- dans les semaines qui ont suivi, plus d’un million de lecteurs se sont connectés sur le site de Strike!, l’article a été traduit dans quinze langues et l’expression "bullshit job" a commencé à être utilisée partout.
- Peu de temps après la publication de l’article, deux instituts de sondage se sont emparés du sujet. L’institut de sondages YouGov a sondé les Britanniques en reprenant leur demandant : « votre emploi apporte-t-il quoi que ce soit important au monde ? » : 37% des répondants ont répondu que ce n’était pas le cas et 13% ont dit n’être “pas sûrs”. Un sondage identique aux Pays-Bas a montré que 40% des salariés néerlandais reconnaissaient que leur travail n’avait aucune raison valable d’exister.
« Indiscutablement, une exploration plus poussée du sujet s’imposait » : c’est la raison d’être de l’ouvrage « Bullshit Jobs » paru en 2018. Pour faire cette exploration, l’auteur a pu s’appuyer à la fois sur ses connaissances scientifiques, mais aussi sur la multitude de témoignages très concrets reçus à la suite de son article de 2013.
Dans un premier chapitre, il analyse ce qu’est un job à la con. Il y propose une définition : « c’est un boulot si inutile, absurde, voire néfaste, que même le salarié ne peut en justifier l’existence, bien que le ‘contrat’ avec son employeur l’oblige à prétendre qu’il existe une utilité à son travail. » Et de compléter : « Ceux qui occupent ces boulots à la con sont souvent entourés d’honneur et de prestige ; ils sont respectés, bien rémunérés (...). Pourtant, ils sont secrètement conscients de n’avoir rien accompli (...), ils savent que tout est construit sur un mensonge. »
Dans le deuxième chapitre, l’auteur décrit les cinq grandes catégories de « jobs à la con » qu’il a pu identifier : les larbins, les porte-flingues, les rafistoleurs, les cocheurs de cases, les petits chefs.
Le chapitre trois explore certaines des conséquences morales et psychologiques qu’entraîne le fait d’être prisonnier d’un job à la con. Cela conduit l’auteur à réfléchir sur ce qu’est l’être humain et ce qui le meut. « D’un côté tout le monde est encouragé à considérer que les êtres humains cherchent systématiquement à maximiser leur avantage (...) d’un autre côté, bien des aspects de notre propre expérience et de celle de nos proches contredisent cette hypothèse ».
À travers de nombreux exemples, il illustre le fait que «Quand le métier censé donner un sens à votre existence ne se résume plus qu’au pire aspect de job salarié, il n’est pas étonnant que votre âme se révolte : c’est une attaque directe contre ce qui vous rend humain ».
Le chapitre quatre, toujours riche en exemples concrets, continue la réflexion sur la violence spirituelle que représente un job à la con.
Dans le chapitre cinq, il se pose la question de comment on est arrivé là : « Le nouvel âge néolibéral était censé n’être que rentabilité et efficacité. Pourtant, les situations d’emploi qu’on observe aujourd’hui semblent indiquer exactement le contraire ». De fait, pendant les Trente Glorieuses, la valeur créée par les gains de productivité était partagée avec les travailleurs. Depuis quelques décennies, cette valeur ne profite plus qu’aux couches managériales. Plus on a supprimé des emplois d’ouvriers , plus on a créé des couches supplémentaires de personnel hiérarchique et administratif. C’est la “montée en puissance du féodalisme managérial”. Enfin, « il y a bien une relation étroite entre la financiarisation de l’économie, l’épanouissement des industries de l’information et la multiplication des jobs à la con ».
Pour David Graeber, le système actuel est un « système d’extraction de rente dont la logique interne n’a plus grand-chose à voir avec le capitalisme, et/ou les impératifs économiques et politiques sont largement confondus. Sur bien des plans il se rapproche de la féodalité médiévale classique ».
Dans le sixième chapitre il s’intéresse aux conséquences politiques de la division actuelle du travail. Dans son style provocateur il constate que « nous avons décidé collectivement qu’il valait mieux affecter des millions de gens pendant des années entières, à des tâches à la con, comme rentrer des chiffres dans des tableurs, préparer des cartes mentales pour des réunions marketing plutôt que de les laisser libre d’apprendre le tricot, de jouer avec leur chien, de monter un groupe de rock expérimental… »
Si nous en sommes arrivés là, c’est que « le travail est de moins en moins regardé comme un moyen en vue d’atteindre une fin… et de plus en plus comme une fin en soi. Mais une fin en soi que beaucoup trouvent néfaste, humiliante et étouffante ».
Pour terminer, David Graeber conduit une réflexion sur les solutions et plus particulièrement sur le revenu universel de base, exemple de mesure qui contribuerait à déconnecter le travail de rémunération et ainsi faire disparaître des jobs à la con. « En laissant chacun décider par lui-même des bienfaits qu’il peut apporter à l’humanité, sans aucune restriction, comment serait-il possible d’aboutir à une répartition du travail plus désastreuse que celle d’aujourd’hui ? »
En mêlant anthropologie, histoire, psychologie et sociologie, David Graeber propose une analyse à la fois captivante et dérangeante du monde du travail d’aujourd’hui.


